| |
La présente rubrique ne se veut qu’une courte évocation de
l’importance que le vélo occupe dans les pensées et les
écrits des écrivains contemporains.
Auteurs
Frédéric
Dard – Jean-Noël Blanc – Gilbert Cesbron - ]–Paulo Coelho –
Pierre Daninos -
Philippe Delerm - Paul Fabre (alias Eddius) - Françoise
Giroud -
Paul Guth – Erik Orsenna – Robert Sabatier – Georges Simenon –
San-Antonio (F. Dard)

Une tranche d’histoire…
[…]
« …Et nous passons à Charles X par la seule magie d’un
feuillet tourné.
- Voilà, je te présente Sa Majesté Charles X !
-
Bel homme, apprécie Bérurier, en bavant sur le portrait
équestre, tu es sûr que c’était le frelot de l’autre ?
-
Mais oui. Ça te choque ?
-
Un peu, mon neveu. Louis XVIII avait la silhouette barrique
et une bouillie de veau trop cuit, tandis que ce M’sieur ;
oh pardon : quelle prestance ! Quelle élégance ! La tête
un peu trop allongée, p’t’être, comme son cheval ! Vise-moi
ces jarrets élancés, ces oreilles dressées, ces naseaux
frémissants et cette longue queue panachée !
-
Mais de qui parles-tu ? fais-je interloqué.
-
Du cheval, nature ! Le peintre l’a peut-être rebecqueté sir
Pégaço, note bien, mais c’est du bel animal ; fais confiance
que les enfants de ce bourrin-là ne charrient pas des
tombereaux de fumier. Ils sont à Antoine ou dans le potager
de M. Boussac !
Satisfait, le Mahousse nous sert une nouvelle tournée de
chianti.
-
C’eût z’été un bon roi, ce Charles Quint, que je n’en fus
point z’autrement z’étonné, décide-t-il.
-
Charles X, hé ! Mauviette !
-
Mande pardon, avec tous ces numéros on s’y perd. Tu vois,
San-A…j’aurais été dans la monarchie, je me serais jamais
laissé refiler un numéro comme à un bourrin de course.
Quand tu mates la liste des engagés, comme on le fait en ce
moment, tout ça ressemble un peu au Tour de France. Je les
imagine, les monarques, avec des maillots de couleurs, des
petites gapettes et de la musette ravitaillement dans le
dos. T’as envie de dire : « Vas-y Henri IV, tu les as ! »
Ou bien : « Baisse la tête, Louis XVI, tu auras l’air d’un
coureur ! » Ou encore : « Change de développement François
Ier, y sont pas loin ! » Avoue que ça serait de la fresque
éloquente, tous ces souverains rangés sur la ligne de
départ. Louis XIV en tête avec ses tifs jusqu’au pédalier
et son maillot jaune de roi-soleil, hein ? Et Henri III,
reine de la pédale, déjà de son temps ! Avec Napoléon, roi
de la montagne ! Le Fausto Coppi de l’Histoire, nettement
détaché dans les étapes alpestres !
Il s’anime, mon gros Béru, s’essouffle, boit pour éteindre
le feu ardent de l’exaltation. Et il reprend :
-
Ça serait facile à apprendre aux mômes, l’Histoire, dans ces
conditions. T’aurais les suiveurs : le duc de Guise avec
ses boyaux dans les mains, et le pape Pie VII
fourbissant la couronne impériale pendant la
course ! Sans compter la caravane
publicitaire avec les Croisés, les Sournois et tout le
titoum ! L’imagination, ça la
leur marquerait et les gosses se feraient plus tartir
sur des bouquins constipés.
…
« Moi
aussi, Gros, je me sens tout chose. Ça n’a pas été
désagréable, tu sais, cette révision. Oh ! bien sûr, elle a
été très incomplète. Je ne t’ai pas cité le dixième des
grands noms de l’Histoire et pas le tiers des faits
importants. Je ne t’ai pas parlé de Bayard, ni de Pasteur,
ni de Clemenceau, par exemple…On a laissé de côté la
conquête du Tonkin, l’Entente Cordiale et nombre de grands
événements, n’importe…Tu as eu droit à l’essentiel pour ce
Tour de France échevelé. Je t’ai donné la liste des
principaux engagés et les numéros de dossards. Tu sais qui
a gagné chaque étape et qui l’a perdue. Et maintenant il
faut que je te dise une chose Béru : ces deux mille ans
évoqués ne représentent rien dans l’histoire de
l’humanité. » […]
Frédéric Dard
alias San-Antonio
« Histoire de France » (Ed. Fleuve Noir)
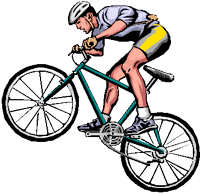
« La montagne est l’algèbre du vélo.
Y voir régner des petits gabarits est un plaisir d’esthète.
Je ne dédaigne pas de pouvoir me prendre, quelquefois, dans
un coup de folie, pour un de ces artistes de la pente. Il
suffit que, par un caprice du destin, je me trouve en forme
dans un col. Cela n’arrive pas souvent. Quand même, il
m’est arrivé de connaître ce bonheur. Je suis bien en
machine, je ne m’essouffle pas, j’enroule bien, je monte au
train, je ne pèse presque plus, je m’envole. Il ne m’en
faut pas plus pour exulter. Oubliées, les vexations de la
plaine où les gros braquets m’ont largué. Oubliée, la
longue torture des faux-plats où je sentais venir le coup de
bambou. Je chatouille les pédales. Je règne, et la
montagne est mon royaume »
Jean-Noël Blanc

Une gamelle
gratinée…
[…] - Dites donc, fit Cayrolle, ça me donne une idée. Pour
tous ceux qui viennent au lycée à bicyclette, réunion à
seize heures au garage des vélos. Fauchier-Delmas, viens
aussi : tu feras l’arbitre à l’arrivée.
-
Non, dit Alain, fous-moi la paix !
Vélos ? arbitre à l’arrivée ? Il en était bien question !
Son dernier espoir de réussir l’examen venait de
s’effondrer. Assis entre François et Jean-Jacques, copiant
par ici, louchant par là, échangeant les brouillons, il
aurait pu s’en tirer ! Mais placé entre deux inconnus…
« Et si, à seize heures, on enfermait tous les prof dans la
salle de réunion ? » proposa Brèche-Dent en rougissant.
C’était la première fois de sa vie qu’il lui venait une idée
de chahut : il s’en sentait fier et honteux, comme le jour
où les autres l’avaient dessalé »…
« C’est une idée à la Morel, dit quelqu’un avec mépris, une
plaisanterie pour les A 2 ? pas pour nous ! »
La course de seize heures, l’épreuve Cayrolle, consistait à
descendre à bicyclette l’escalier du proto depuis le second
étage. Quand le règlement leur en fut révélé, la plupart
des possesseurs de vélos se désistèrent : leurs pneus
étaient fissurés, leurs freins déréglés, etc.
« C’est vos fesses qui sont trop serrées, bandes de
dégonflards ! » fit Cayrolle.
Il ne restait plus en ligne que lui, Mollard, Gros Genoux et
Darseval, toujours volontaire « Pour Dieu, pour le Roy, pour
la Patrie ! » - et pas d’arbitre à l’arrivée, puisque
Fauchier-Delmas se désintéressait de l’épreuve.
Ils prirent le départ, freins serrés, dents serrées.
Mollard trouva cependant la force de plaisanter : « Chez
nous, ça va vite mais faut pas être pressé ! »
Avant le premier palier, Darseval était à terre, l’arcade
sourcilière saignante : « Pas de mal ! » cria-t-il d’une
voix qui muait d’émotion.
Gros Genoux qui s’était par deux fois accroché à la rampe,
se vit disqualifié. De plus, manque d’habitude, il avait
fait un accroc à son pantalon long qui datait de la veille.
Tu parles d’une poisse !
Peu après, on entendit un craquement : les câbles de freins
de Mollard venaient de péter, ne pouvant supporter à la fois
la pente de l’escalier et le poids du garçon.
Un Meeeeerde ! prolongé, angoissé, montant du fond de
l’abîme fut la dernière parole qu’on entendit du gros.
Cayrolle se déclara vainqueur par élimination, descendit de
vélo, non sans soulagement, et partit, suivi de dix curieux,
à la recherche des restes du malheureux Mollard. Hélas !
on n’en retrouva rien. Gros Genoux, horrifié, pensait que
déjà les vautours, peut-être…Mais Cayrolle conclut : « Tant
mieux ! Il n’a pas de mal et il est reparti sans nous
attendre ! Vous venez ? »
Et les garçons disparurent, le cœur léger, tandis que deux
étages plus bas…
Mollard n’avait dû son salut qu’à sa torpeur. Un nerveux se
fût accroché au guidon, eût tenté des manœuvres ; le gros
garçon se laissa porter. Et sa machine, de palier en
palier, le conduisit jusqu’au sous-sol à une vitesse sans
cesse croissante et dont Bigloteux eût aisément calculé la
formule. Là, elle se jeta en bélier contre la porte même de
Betelgeuse qu’il ouvrit avec son crâne avant de bouler,
inanimé, sur le divan.
Mollard reprit ses sens aussitôt – mais comment l’aurait-il
cru ? Il venait d’un escalier gris, d’un noir corridor ; il
se retrouvait sur un sofa oriental, devant un narguilé, une
bouteille de calvados, une boîte de cigares…
Il n’avait pas lu assez de romans médiocres pour savoir que
l’on doit, dans ce cas, se pincer, dire tout haut :
« Suis-je éveillé ?3 Il entra donc de plain-pied dans son
rêve : but, fuma, rota, vomit dans son rêve, jusqu’à ce
qu’ivre d’émotion et de calvados, il s’endormit dans son
rêve.
C’est dans cet état que le trouvèrent les trois
Mousquetaires, quelques minutes plus tard, auprès d’une
bicyclette brisée et d’une bouteille presque vide. Sans un
mot, d’Artagnan prit Mollard sous les aisselles et
Rouquinoff le saisit par les pieds. François passa devant,
tenant les restes du vélo et servant d’éclaireur. Ils
portèrent sans encombres le seul vrai gagnant de l’épreuve,
Cayrolle, et sa malheureuse machine jusqu’à la cour de
l’infirmerie où personne ne passait jamais[…]
Gilbert Cesbron « Notre
prison est un royaume »
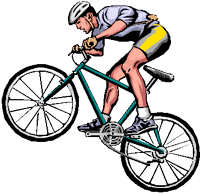
[…] La vie est à l’image d’une grande course cycliste dont
le but est pour chacun l’accomplissement de sa Légende
Personnelle.
Sur la ligne de départ, nous sommes tous animés par les
mêmes sentiments de camaraderies et d’enthousiasme. Mais à
mesure que la course se déroule, la joie initiale fait place
aux vrais défis : la fatigue, la monotonie, les doutes sur
nos capacités… Nous constatons que certains amis ont renoncé
à relever le défi – ils courent encore, mais seulement parce
que l’ont ne peut pas s’arrêter au beau milieu d’une route.
Ils sont nombreux, ils pédalent l’un à coté de la voiture de
secours, ils bavardent entre eux, ils accomplissent un
devoir.
Nous finissons par prendre nos distances ; alors il nous
faut affronter la solitude, l’imprévu qui surgit des virages
inconnus, les difficultés matérielles causées par notre
bicyclette. Finalement, nous nous demandons si tout cet
effort en vaut vraiment la peine.
Oui il en vaut la peine. Simplement, il ne faut pas
renoncer. […]
Paulo Coelho (Maktub)

40 millions de sportifs
[…] Il existe plusieurs belles époques pour visiter la
France, mais il en est une qui risque de fausser votre
jugement : celle qui s’étend environ du 1er au 25
juillet. L’un de mes premiers voyages en France se situa
pendant cette période. Venant de Gibraltar, j’avais
traversé les Pyrénées et poursuivais ma route vers Paris
lorsque, à un croisement deux gendarmes arrêtèrent ma
course.
« On ne passe pas ! » me dirent-ils.
Ayant encore, à cette époque, l’habitude anglaise de ne
jamais poser de questions, j’obtempérai sans demander
pourquoi. La vue d’un grand déploiement de forces
policières m’incita d’abord à penser que l’on était sur le
point de cerner un bandit de grand chemin. Cependant,
apercevant sur la Nationale un nombreux public qui
conversait joyeusement avec la maréchaussée, j’en déduisis
que l’événement était moins dramatique. Une colonne de
blindés à l’arrêt de l’autre côté de la route, sur un chemin
de traverse, me fit croire un instant à un défilé
militaire. Mais non : car bientôt, j’entendis le capitaine
de gendarmerie dire au jeune lieutenant qui commandait les
chars et manifestait son impatience en se donnant de petits
coups de badine sur les bottes (ses hommes paraissaient
beaucoup moins fâchés) :
« Manœuvres ou pas manœuvres, on ne passe pas ! »
Il était clair, en somme, que personne ne passerait, ni les
Français avec leurs blindés, ni le major Thompson avec sa
torpédo, ni même ce monsieur qui, ayant extrait son
importance d’une très importante voiture, le classique
coupe-file à la main, obtint pour toute réponse ce :
« Faites comme les autres, attendez ! » que je devais par la
suite entendre souvent. Je conclu de ces prémisses que tout
le trafic était interrompu pour laisser la voie libre au
Président de la République et à sa suite, lorsqu’un cri
jaillit des poitrines : « Les voilà »
Ce singulier pluriel me fit un instant supposer que le chef
de l’Etat allait apparaître avec mes Très Gracieux
Souverains, alors en France. Quelle ne fut pas ma surprise
de voir surgir, en fait de Gracieuses Majestés, deux
individus mâles se dandinant sans grâce sur leur bicyclette,
curieusement vêtus de boyaux et de maillots aux couleurs
criardes, à peine culottés pour ainsi dire nus, crottés et,
dans l’ensemble, assez choquants à voir. On voulut bien
m’expliquer –sans que j’aie rien demandé que ces gens,
faisant le tour de France à bicyclette, gagnaient Paris le
plus vite possible, ce qui me parut étrange. Mais, après
tout, ce sont là des choses au sujet desquelles un Anglais,
ne s’étonnant de rien, n’a pas à manifester de surprise
déplacée. De temps en temps, à Londres, un citoyen, soit
par caprice, soit par amour du sport, traverse Piccadilly en
blazer rouge et culotte blanche, mais il serait du dernier
mauvais goût de se retourner sur lui. Chacun est libre
d’agir et de se vêtir à sa guise, sans crainte d’être
remarqué, dans un pays où le bon ton commande de voir les
gens sans les regarder.
Ce qui me stupéfait – en l’occurrence – n’était pas tant la
tenue négligée de ces messieurs, mais le fait que la
circulation fût paralysée pour eux par les soins de la
police. Pour eux et pour un cortège de camions appartenant
à des firmes de pâtes ou d’apéritifs qui, à première vue,
n’avaient rien à faire dans l’histoire, mais y étaient,
renseignement pris, tout à fait liées. Je sais qu’il existe
un Tour d’Angleterre du même genre, mais si peu semblable !
D’abord nos coureurs, loin d’interrompre la circulation, la
suivent : ils s’arrêtent aux feux rouges, comme tout le
monde ; il s’agit d’amateurs qui, à l’abri des
combinaisons publicitaires, se doublent en s’excusant et
quittent leur vélo pour le thé ; enfin ces jeunes gens,
auxquels personne ne prête attention, sont correctement
habillés.
*
Je n’arrivai à Paris que fort tard dans la nuit. La
situation au Bengale, où j’avais dû – pour des raisons trop
longues à exposer ici et qui, du reste, ne regardent
personne – laisser Ursula, me préoccupait. En effet,
l’émeute grondait à Calcutta, la police avait dû ouvrir le
feu sur la foule et il y avait eu eventually deux
cents morts. Cela je le savais déjà à Gibraltar. Mais je
voulais savoir plus. J’achetai donc la dernière édition, et
même toute dernière spéciale d’un journal du soir où
un titre étalé sur huit colonnes annonçait :
GARRALDI ET BIQUET ENSEMBLE DEVANT LES JUGES DE PAIX
Pensant qu’un grand procès arrivait à son dénouement, je
m’apprêtais à lire les débats à l’ombre d’un alléchant
sous-titre : Le démon florentin trahi par ses
domestiques, lorsque mon œil fut attiré par une coupe
transversale des Pyrénées qui s’étendaient au sud du
journal. J’appris un peu plus tard que Garraldi et Biquet
étaient les héros du Tour de France : par « juges de paix »,
il fallait entendre – suivant une des métaphores dont sont
friands les chroniqueurs sportifs – le Tourmalet et
l’Aubisque ; le démon était le « maillot jaune », les
domestiques, ses coéquipiers. Quant aux deux cent
morts de Calcutta, ils étaient enterrés en quatre lignes
sous le Mont Perdu.
Je ne saurais donc trop recommander à mes honorables
compatriotes, si du moins ils veulent être renseignés sur
les événements du monde en général et de l’Empire en
particulier, de ne pas venir en France au mois de juillet
sous peine de voir le Commonwealth soumis à la loi
humiliante du grand braquet.
Quelques jours plus tard, comme je parlais du Tour de France
à mon ami le colonel Turlot et lui confiais que je
n’entendais rien à toute cette affaire, il riposta en me
révélant qu’après avoir essayé à trois reprises de
comprendre quelque chose à un match de cricket il avait dû
subir, chez un psychiatre londonien, une longue séance de
relaxation. Et il ajouta : « Savez-vous que des millions de
sportifs suivent chaque jour la course avec enthousiasme,
mon cher Thompsonne ?
-Voulez-vous
dire, my dear Tiourlott, qu’ils suivent les coureurs
à bicyclette ? »
Turlot me regarda en souriant comme si je voulais joker.
Non : les « sportifs » dont il parlait luttaient bien chaque
jour, mais seulement pour acheter la toute dernière
spéciale ou avoir la meilleure place à l’arrivée.
Je découvrais là une nouvelle et fondamentale différence
entre nos deux pays : les Anglais se disent sportifs
lorsqu’ils font du sport. Les Français se disent sportifs
lorsqu’ils en voient. Il y a donc, aussi pénible que la
vérité puisse paraître à mes compatriotes, plus de sportifs
en France qu’en Angleterre. On ne saurait d’ailleurs
assurer que les Français ne font pas de sport lorsqu’ils
sont de simples spectateurs. Ne serait-ce qu’au cinéma, par
exemple, surtout à l’époque du Tour de France. M. Charnelet
y est venu plutôt pour se détendre. Et voilà que, dès les
actualités, il est obligé d’enfourcher son vélo pour avaler
les 700 kilomètres de route (car, si les coureurs
n’accomplissent qu’une étape à la fois, le spectateur, lui,
doit en absorber cinq ou six, quelle que soit son envie de
monter le Galibier ou de descendre le col d’Allos. M.
Charnelet, auquel on n’a pas demandé son avis, roule donc
dans l’enfer des pavés du Nord, crève aux
environs de Longwy, dérape, repart décollé, embrasse une
Alsacienne d’étape, gravit, malgré ses furoncles, les lacets
traîtres du Ventoux et, finalement, suprême punition,
traverse les étendues désolées de la Crau. Rien de plus
accablant que la traversée forcée de la Crau dans un cinéma
des Champs-Élysées vers 22h30. Le peloton s’égrène. Le
peloton musarde. Le peloton peine. Le peloton se
regroupe. Le peloton tricote…On évalue à une quinzaine de
millions les Français qui s’incorporent mentalement à ce
peloton et se sentent un instant les jambes – que dis-je ! –
les bielles dorées de Garraldi, le « dieu des cimes »
, ou le mollet rageur de Biquet, le courageux petit
Français auquel le méchant sort fait toujours des
misères, mais qui saura se surpasser à l’heure de la
critique.[…]
Pierre Daninos
« Les carnets du major Thompson »
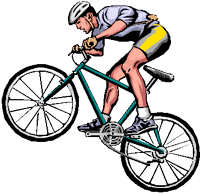
C’est le contraire du vélo, la bicyclette. Une silhouette
profilée mauve fluo dévale à soixante-dix à l’heure : c’est
du vélo. Deux lycéennes côte à côte traversent un pont à
Bruges : c’est de la bicyclette. L’écart peut se réduire.
Michel Audiard en knickers et chaussettes hautes au comptoir
d’un bistro : c’est du vélo. Un adolescent en jeans descend
de sa monture, un bouquin à la main, et prend une menthe à
l’eau à la terrasse: c’est de la bicyclette. On est d’un
camp ou bien de l’autre. Il y a une frontière. Les lourds
routiers ont beau jouer du guidon recourbé : c’est de la
bicyclette. Les demi-courses ont beau fourbir leurs
garde-boue : c’est du vélo. Il vaut mieux ne pas feindre, et
assumer sa race. On porte au fond de soi la perfection noire
d’une bicyclette hollandaise, une écharpe flottant sur
l’épaule. Ou bien on rêve d’un vélo de course si léger : le
bruissement de la chaîne glisserait comme un vol d’abeille.
A bicyclette, on est un piéton en puissance, flâneur de
venelles, dégustateur du journal sur un banc. A vélo, on ne
s’arrête pas : moulé jusqu’aux genoux dans une combinaison
néospatiale, on ne pourrait marcher qu’en canard, et on ne
marche pas.
C’est la lenteur et la vitesse ? Peut-être. Il y a pourtant
des moulineurs à bicyclette très efficaces, et des petits
pépés à vélo bien tranquilles. Alors, lourdeur contre
légèreté ? Davantage. Rêve d’envol d’un côté, de l’autre
familiarité appuyée avec le sol. Et puis… Opposition de
tout. Les couleurs. Au vélo l’orange métallisé, le vert
pomme granny, et pour la bicyclette, le marron terne, le
blanc cassé, le rouge mat. Matières et formes aussi. A qui
l’ampleur, la laine, le velours, les jupes écossaises ? A
l’autre l’ajusté dans tous les synthétiques.
On naît à bicyclette ou à vélo, c’est presque politique.
Mais les vélos doivent renoncer à cette part d’eux-mêmes
pour aimer – car on n’est amoureux qu’à bicyclette »
Philippe Delerm
(La bicyclette et le vélo)

Moi, mon truc, c’est le vélo
[…] « …Diversité…J’ai tout mis sur mes
bécanes. Premiers brevets de Paris-Brest-
Paris jadis, avec des torches. Attachées au guidon avec des
élastiques. Attachées aux moyeux avec des colliers
artisanaux. Boîtiers larges, boîtiers longs, boîtiers
carrés, boîtiers ronds. Piles à ceci et piles à cela.
J’éclaire plus blanc, j’éclaire plus loin, j’éclaire plus
longtemps. Quel baratin, mes piles ! Que d’obscurité elles
m’auront donnée ! Grâce à leur faisceau permanent de noir,
elles m’ont évité de voir les routes de la nuit, leurs
chausse-trapes, leurs nids de poule, leurs trous d’obus.
Grâce à elles, tout a été estompé, effacé, occulté. Les
côtes et les descentes. Les vrais et les faux plats. Les
hectomètres et les kilomètres. Les cassis et les
caniveaux. Les pavés et les gravillons. Les plaques
d’égouts. Et les bouses de vaches. J’ai pu ainsi pédaler
sans rien voir. Aucun spectacle nocturne ne m’a jamais
distrait. Jamais détourné de ma concentration. J’ai
pédalé, de nuit, dans le noir absolu. Sans voir où je
passais. Y serais-je passé, voyant ? En tout cas, j’ai
là-dessus plus de souvenirs que si j’avais mille ans... […]
[…]
Et passons à mes états d’âme. Là, vous me voyez venir.
Suis-je coureur ? Cyclotouriste ? Cyclosportif ?
Contemplatif ? Couraillon ? Vous avez perdu. Rien de tout
cela. Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée du
vélo. Et tous les théoriciens du monde n’y pourront rien.
Eux qui voudraient que le vélo fût ceci à l’exclusion de
cela. Fût cela à l’exclusion de ceci. En ce domaine, comme
en bien d’autres d’ailleurs, sévit un gentil terrorisme…
Drôle d’idée de réduire le vélo à une pratique unique. Et
pourquoi faudrait-il que monsieur Jean Dupont ne dût
qu’imiter Merckx ? Ou ne dût que l’exorciser ? Flâner,
flinguer, c’est tout un. Comme impuissance et impatience.
Fort, faible, que signifie ? Je ne fais pas de mes forces
relatives un argument de mes mépris. Ni de mes faiblesses
réelles un alibi. Mon vingt-cinq à l’heure ne suffit pas à
me définir comme poète. Ni comme flèche. Il est des poètes
rapides. Et des béotiens lents. Et un vélo, même chevauché
avec nonchaloir, ne conduit pas nécessairement au Parnasse.
Fût-ce en 28 x 28 ! Bref, je suis un hérétique. Convaincu
que mon bonheur est dans l’hérésie. Dans toutes les
hérésies. Cycliste, mais pas forcément contemplatif. Quand
je danse, je danse, disait Montaigne… Randonneur, mais pas
coureur. Sportif, mais pas champion. Je ne trouve
rien à redire au contemplatif. Ni au randonneur. Ni au
coureur. Ni au champion. Tous cyclistes, tous sportifs.
Leur cocktail est fait des mêmes choses. Seules diffèrent
les doses. Et moi, cycliste. Et cycliste heureux. Tout
bêtement !
…
Les abus de langage d’abord ! Qui ont tôt fait de vous
transformer les géants de la route en geignants de la
soute. Et qui, couperets, vous jugent les gens sur
l’amphétamine ! Censeur, rongé de nicotine, et qui bave sur
les dopés. Holà ! Sus aux abus évidemment ! Mais ne les
faites pas tout noirs ! Un peu moins de mépris, touchez pas
à nos potes. Le plus dopé de tous n’est pas celui que l’on
pense…Et il me déplaît que l’alcoolique prenne pour cible le
fumeur. Et que les piétons maxitons ne jettent pas à la
poubelle tous les vélos ho ! ho ! Ne prenez pas l’eau du
bidon pour du poison. Ou bien alors méprisons-nous !
Piétaille et couraille, jumping doping, voyez vos torts.
L’éprouvette pour tous ! Ou pour personne ! Et ne faisons
pas semblant de croire que le dopage est d’aujourd’hui. De
mon temps, moi , Monsieur… Stop, mon jeunot, étais-tu donc à
Olympie ? Pour laver plus blancs nos ancêtres ? Monsieur
Propre n’a pas d’époque. Hélas ! Monsieur Sale non plus… Et
que les potions me navrent, qui salissent nos vélos ! Ne
seraient-elles que lotions dès qu’elles ne pédalent plus ?
Et nos poubelles piétonnières, débordant de médicaments,
sont-elles vierges de dopants ? Faudra-t-il viser le
toubib ? Et chuchoter : le plus dopeur de tous est-il celui
qui panse ? Vélo, défauts comme les autres ; Plus que les
autres ? Si vous voulez… Mais y a des dopés qui pérorent à
nos desserts dominicaux. Médecins, tracez des frontières…
Dupont, sang de Durand, pour suivre le peloton des
cyclistes, fi ? Et pour suivre le troupeau des vivants,
hip ? Ho ! Eddius, arrête un peu ! Tu défends le sel de ta
soupe ? Non, mon colon, je marche à l’eau. Mais vélo voué
aux gémonies, rouge au front et moutarde au nez ! Alors sus
aux saloperies ! Mais accordez-moi cette évidence : Dopez
mon facteur, il ne gagnera pas Paris – Roubaix…Faut
être costaud pour faire du vélo. Je ne suis pas Hinault,
moi, mon bon Monsieur ! !
Moi non plus, je ne suis pas Hinault ! Tenez, je ne suis pas
Poulidor non plus ? Mais moi, je pédale encore. Et je
grimpe encore plus de cols par an que le gentil Charly, vous
savez, l’Ange de la montagne ! On peut écrire une lettre
sans être Madame de Sévigné. Chanter sans être Caruso.
Aimer sans être Casanova… Tenez je suis pas Balzac ? Ça
n’empêche pas de vous écrire cette Comme Eddy humaine…
Allez
va ! Enfourchez un vélo. Vous laissez pas influencer par
les exploits des géants. Eux, c’est l’élite, le dessus du
panier. Mais au fond, où nous sommes, y a encore des
feuilles de salade comestibles… Commencez pas, bien sûr,
avec des braquets fait pour le demi-fond ! Pas trop de dents
devant, beaucoup de dents derrière. Débutez comme ça. Si
vous vous découvrez des ailes, vous inverserez. Mais
rappelez-vous l’essentiel : trente dents et un bon
estomac ! Cet estomac, ne le détraquez pas. Excluez tous
dopages, purée et eau notamment ! Car rappelez-vous : Dopez
mon facteur, il ne gagnera pas Paris – Roubaix.
Mais j’y pense…Vous n’êtes peut-être même pas facteur ! […]
Paul Fabre alias Eddius
« Mes vélos… »
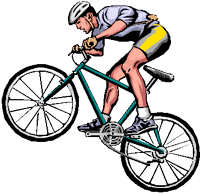
« Pourtant, dans le phénomène d'identification qui se
produit toujours avec un champion, tout se passe comme si
une grande partie du public refusait de s'identifier plus
longtemps à Jacques Anquetil le Gagneur.
Le comportement de l'homme n'est sans doute pas étranger à
cette réaction.
Il ne cherche pas à séduire. Il ne s'excuse ni de sa fortune
ni de ses succès. Il n'invoque pas la chance qui a touché de
son aile le fils d'un maraîcher pour en faire l'une des
gloires du sport français mais seulement les efforts qu'il a
fournis. Il ne dit jamais : " C'est merveilleux, d'être le
meilleur... " Mais : " C'est dur, d'être le meilleur. " On
le sent animé d'une fantastique volonté de puissance.
Impérialiste. Il est organisé, froid, méthodique, habile à
mener ses affaires. C'est un vainqueur scientifique et non
le produit de quelque " furia francese ".
A la limite, ce Normand pourrait être Anglo-Saxon. Bref, il
est insupportable.
L'autre, Poulidor, sollicite la sympathie. A toujours
d'excellentes raisons pour expliquer ses défaites. Apparaît
comme une sorte d'enfant de la malchance et fait penser à la
souris qui dit à l'éléphant : " Bien sûr, tu es plus grand
que moi, mais moi, j'ai été malade quand j'étais petite. "
Un bon gars, quoi, qui aurait sûrement gagné le Tour une
fois ou l'autre s'il n'avait pas eu la déveine d'être le
contemporain d'Anquetil.
Et on s'attendrit. Et on trouve qu'au fond, ce n'est pas
juste. Et on a le sentiment d'être vaguement " roulé " par
Anquetil, parce qu'il possède à la fois la tête et les
jambes. Et on prend sa supériorité, son calme, son assurance
en grippe. Il est inhumain, dit-on.
Que signifie donc être humain ? Dans le langage courant :
avoir des faiblesses, des failles, partager le lot commun,
où il y a plus de tuiles que de joies, participer aux
malheurs des autres et les comprendre. C'est, en effet, être
humain.
Mais on pourrait aussi ajouter : être humain, c'est dominer
l'animal. Et où le domine-t-on mieux que dans l'exercice du
sport? L'extraordinaire maîtrise du moindre muscle que
supposent une passe, un saut, une course, la victoire sur
des réflexes, sur la peur, et parfois sur la douleur
qu'exige une coordination efficace de tous les gestes, c'est
l'une des belles manifestations " humaines " de dépassement
de soi. Les animaux ne cherchent jamais à se projeter plus
loin, plus haut, plus vite. Ils ne font pas de compétition.
Jacques Anquetil est un magnifique athlète. Ce n'est pas une
mauvaise façon d'être humain. Mais pour sa physionomie
publique, il vaudrait mieux, sans aucun doute, qu'il se
fasse photographier avec un petit chat dans les bras, ou
que, parlant de ses rivaux, il déclare : " C'est lui qui
méritait la victoire... ", ce que jamais personne ne pense »
Françoise Giroud
(extrait de presse)

Premiers tours de manivelle
[…]
J’accédai à la virilité par la bicyclette. Mon père avait
la mystique de ce moyen de transport. Il représentait pour
lui infiniment plus qu’un procédé mécanique permettant de se
rendre rapidement d’un point à un autre. C’était d’abord la
plus belle des inventions depuis le début des temps.
« L’auto a un moteur et l’avion aussi. Le chemin de fer,
n’en parlons pas. Mais dans la bicyclette, c’est toi le
moteur. Tu ne dépends que de toi. »
La bicyclette, libératrice de l’homme, et guérisseuse ! Mon
père lui devait la vie. Dans son enfance, chétif, malingre,
il dépérissait. Les médecins l’avaient condamné. En
désespoir de cause l’un d’eux s’écria : « Faites-lui faire
de la bicyclette ! »
« La bicyclette m’a donné de l’appétit. Je me suis mis à
manger, à profiter ». J’étais sauvé !… »
Quand mon père m’apprit à monter à bicyclette, ce fut un
rite. Il me soumettait à une initiation. Je passais à un
stade supérieur de la condition humaine. J’avais commencé à
marcher à quatre pattes, puis sur mes deux jambes.
Maintenant je me haussais au roulement sur deux roues, qui
relevait de l’ordre des planètes.
Mon père ne se contenta pas de me jucher en selle et de
m’exposer directement aux conséquences des chutes. Il
débuta par un principe auquel il donna la magnificence des
lois de Newton.
« Tu tournes la roue d’un côté où tu sens que tu vas
tomber, devenait, dans sa bouche, aussi péremptoire que
Les orbites planétaires sont des ellipses dont le soleil
occupe un des foyers. »
Il ouvrait une carrière infinie à mes incertitudes.
Hissé, au-dessus du sol, sur deux cercles que mes pieds
devaient mouvoir, je me demandais pas : « De quel côté
vais-je tomber ? » Tout m’était gouffre.
« Tu sens bien tout de même de quel côté tu vas tomber ?
-
Mais non, je tombe de partout ! »
L’espace
entier se liguait pour me précipiter. Ma tête, mes bras,
mes jambes, rivalisaient de lâcheté. Sur les côtés, devant,
derrière, le vide les charmait. Pour obéir au principe de
mon père c’est dans toutes les directions, comme un
gyroscope, que j’aurais dû faire tourner ma roue.
Mais j’avais un appétit invincible de choir. Pour tenir
cette position éminente ? Pourquoi me défendre, à coups de
roues, à chaque seconde ? Tomber me paraissait voluptueux.
M’abandonner de tout mon poids, à ce qui m’appelait.
Rejoindre la terre, m’y enfoncer.
Et puis une indignation me soulevait. J’avais cru que les
cyclistes roulaient, droit devant eux, comme sur un rail.
Je n’avais jamais pensé que leur équilibre était fait de
cette foule de battements perpétuels, de ces myriades de
titubations d’ivrognes. Il reposait sur un mensonge.
Ma bicyclette à roue fixe me condamnait au pédalage à
perpétuité. Comme dans tout mouvement continu dont je dois
être le moteur, très vite je m’ennuyais. Je négligeais
d’envoyer à mes pieds mon influx. Dégoûtés, ils se
comportaient en semelles de bronze.
« Nom de D… tu roupilles ?… criait mon père. Pédale !
Pédale !… »
Je me dressais sur mes pédales. Ivre de rage, je tendais la
chaîne à la casser. La bicyclette bondissait. Mon père
s’époumonait à me suivre. La conscience du danger
l’étreignait.
« Ne me lâche pas », crias-je, éperdu.
J’avais honte de cette vitesse factice, dont le bras de mon
père était le support.
« Alors, monsieur Guth, ça roule, ce fils ? demandaient des
passants.
-
Oui, oui », répondait mon père
essoufflé.
Pour
répondre, il me lâchait une seconde.
« Ne me lâche pas ! » criais-je de nouveau.
Ma tête, les jambes, mes bras prenaient aussitôt le poids du
plomb. Mes pieds se crispaient sur les pédales pour
repousser un abîme. Je devenais une statue de pesanteur qui
n’aspirait qu’à se fracasser. […]
Paul Guth
« Mémoires d’un
naïf »
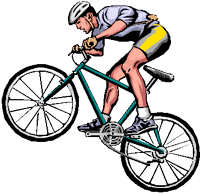
Quand je roule j’aime tout. J’aime l’exercice physique,
j’aime la vitesse que l’on peut moduler, le rythme, le
bruit, les odeurs. Ce qui est formidable, c’est la
sensation de glisser sur un tapis, à côté de la nature pour
ne pas la gêner. On le la touche pas, on ne la marque pas
comme dans la marche, on glisse véritablement. Le vélo,
c’est la douceur
Erik Orsenna

[…] Un peu plus tard, le grand flandrin Anatole pot à
colle qui ne connaît pas l’Dentol, connut un succès
personnel. Il remontait la rue, habillé en coureur
cycliste, avec des boyaux croisés sur sa poitrine et un
dossard affichant un gros numéro 9 et l’inscription A.C.B.B.
de l’Association Cycliste de Boulogne-Billancourt, et
surtout tenant un vélo, de course par le milieu du guidon.
Les pavés faisaient tressauter la bécane et tinter le
timbre. Osseux, voûté, les jambes torses, Anatole plissait
les yeux sous le soleil et regardait par-dessus les têtes
vers un horizon où se profilait la cime du Galibier. Il
cala la bicyclette avec le pédalier contre le trottoir,
s’assit en attendant de recevoir les hommages qu’il guettait
un œil furtif, tandis que quelque part dans la rue un
gramophone faisait entendre That man I love chanté
d’une voix nostalgique et nasillarde sur un fond de
saxophone et de trompette bouchée.
Anatole savait bien que quelque gamin viendrait lui demander
le prêt de sa machine pour faire en danseuse le tour du pâté
de maisons, il savait aussi qu’il refuserait d’un air
entendu alléguant qu’un tel coursier, c’est comme un
porte-plume réservoir ou une femme : ça ne se prête pas !
Le fils de Ramélie, Jack Schlak, Lopez et Toudjourian
vinrent les premiers suivis de Loulou et d’Olivier. Les
mains dans les poches, ils admirèrent la merveille avec son
guidon recourbé recouvert de chatterton et sa selle allongée
comme le museau d’un cheval de course, s’enhardissant à
vérifier le serrage des papillons, la puissance des freins
ou, du pouce, le degré de gonflage des boyaux. Anatole
voulut bien soulever la bécane et en faire éprouver à chacun
la légèreté, puis ils se lancèrent dans une discussion
comparative entre les pistards des Six Jours et les routiers
du Tour de France, avant d’en venir à opposer les champions
français, belges et italiens. Anatole exhiba enfin ses
chaussures cyclistes et montra la position idéale de la
pointe du soulier dans les cale-pieds des pédales.
-
Peut-être que tu seras un champion ! supposa Olivier.
Anatole, récemment arrivé sixième sur douze dans une course
amateurs à la « Cipale », pensait qu’il l’était déjà et
prenait des airs mystérieux et lointains. Une observation
de Ramélie sur l’absence de garde-boue suscita des sourires
ironiques et on dédaigna de lui répondre. Puis Anatole
croqua un morceau de sucre, ce soutien des champions dans
les moments de défaillance, s’étira, passa son épaule dans
le cadre et s’éloigna en portant avec amour ce qui désormais
était toute sa vie. […]
[…] Le départ du Tour de France, rassembla tous les intérêts
et, dans la rue Labat, on ne parla plus que de cela. Les
hommes se promenaient avec des journaux ouverts à la page
sportive. On y voyait André Leducq qui s’imposait en
champion et il y avait partout des images de grands insectes
dressés sur leurs pédales, de caravanes publicitaires avec
distributions d’échantillons à la volée, des villes-étapes
en liesse à l’arrivée de la Babel du cyclisme. Les bistrots
présentaient des tableaux noirs avec, à la craie, les
classements par étapes et général, l’indication des
kilométrages et les temps de retard sur le maillot jaune, et
les hommes discutaient interminablement en les regardant.
Toute la France avait des relents de graisse et
d’embrocation, poussait les champions par la
selle,distribuait des boissons et des musettes-repas à la
volée.[…]
Robert Sabatier
(Les Allumettes suédoises)
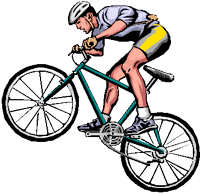
Une course cycliste ! C'est bien plus simple que je me le
figurais. Un boulevard grisaille ; une foule grouillante des
deux côtés, le long des cordes ; des sergents de ville qui
gesticulent, voilà pour la toile de fond.
Une longue table qui succombe sous le poids des victuailles
de toutes sortes, deux camions automobiles échoués sur le
terre-plein, au milieu d'une sorte de box clôturé de piquets
et de cordes ; deux grands chaudrons jaunâtres, telle est la
mise en scène. Comme accessoires, notons un gros, très gros,
excessivement gros Monsieur, enveloppé d'un imperméable
brun, enfournant dans une large, très large bouche, petits
pains, oranges, côtelettes qui lui tombent sous la main.
Citons aussi un grand maigre, une petite brosse à dents
rousse sous le nez, le corps serré d'un complet brun à
martingale. Quelques brassards circulant de-ci, de-là. Pour
les 77 personnages principaux, les coureurs, une seule
description suffira. Des corps tordus, dans des vareuses
sales, cheveux ébouriffés ; avec cela des plaques d'un blanc
dégradé collées de-ci de-là à la peau. L'action aussi se
ressemble pour tous. Un brusque virage, arrêt non moins
brusque, numéro crié, signature écrasée sur une grande
feuille.
Ingurgitation d'un nombre illimité de tasses de café ou de
thé, suivie de quelques petits pains. Ensuite ravitaillement
rapide en victuailles. Brusque départ et c'est tout. Toute
l'action ne dure que cinq minutes, entrecoupées de gestes
brusques et de cris s'entrecroisant.
Et voilà une course cycliste telle qu'on la voit lorsqu'on
regarde par le gros bout de la lunette.
«Ne vous avais-je pas dit que c'était simple !»
Georges Simenon

Un retour de
flamme non espéré…
[…]Nous retrouvons le peloton, plus étiré qu’un bandonéon
accroché à un clou. Effectivement, le maillot violet, bleu
et vert du champion ibérique flotte à quelques encablures
des autres.
-
Il est aux portes de l’abandon ! m’exclamé-je, car je suis
un lecteur assidu de l’Équipe et rien de ce qui
touche au vocabulaire sportif ne m’est étranger.
-
Arrête-toi ! m’enjoint le réputé masseur.
Il fait peine à voir, Alonzo. Il a des chandelles grosses
comme mon pouce sur le front, le nez pincé, les yeux qui
bredouillent et les genoux qui font bravo. Sa langue a la
couleur du drapeau espagnol. Et quand il respire, on se
croirait dans une gare de triage.
-
Stop ! internationalise le Gros.
Comme le coureur ne demande que ça, il se grouille de
délacer ses cale-pieds pour se délasser. Lors, l’Ingénieux
déroule un écheveau de nylon transparent. Il attache une
extrémité du filin invisible à un bouchon.
-
Ouvre ton bec, ma petite tête de condor ! ordonne-t-il.
Je traduis d’abord de l’argot en français, puis du français
en espago.
Giro obéit.
Le Masseur lui glisse le bouchon dans la bouche.
-
Tu l’auras ton Big Prix of the mountain, mon pote,
promet-il, fais confiance à Béru.
L’autre ne pige toujours pas.
-
Causes-y, à cette truffe, supplie mon compagnon. Dis-y
qu’on va l’haler mine de rien. Qu’il tienne bien sa gauche
surtout ! Toi tu roules en klaxonnant à tout va et tu
doubles le peloton. Y a cinquante mètres de fil. Ce qu’il
faut, c’est qu’il faut pas que d’autres endoffés traversent
dans le tervalle.
-
Pas très règlo, ton système, réprouvé-je.
Mais Béru se fâche.
-
Le catéchisme c’est l’église d’à côté, mec. Alors écrase.
Dans ce Tour t’es pas mon supérieur hiéraldique mais mon
support-donné.
Je donne donc au Condor pyrénéen les explications voulues.
C’est faire fi de la fierté espagnole. Descendant de
Charles Quint, il est, Alonzo. Le raisin de la noble
Espagne circule dans ses tuyaux. Il fait « groin, groin »
vu qu’il ne peut articuler autre chose avec le bouchon qui
lui remplit le clapoir. Mais il fait « groin, groin » sur
un ton réprobateur. Il préfère abandonner. Il n’a pas
l’âme d’un frelaté. Ne pas monter bien haut, peut-être,
mais tout seul ! Voilà ce qu’on lit dans ses yeux qui
fulminent. Voilà ce qu’il ponctue et acuponctue de la main
et de la jambe.
-Il nous les brise ! fait le Gros, démarre !
Je repars. Las, Alonzo n’a pas encore réussi à se
débarrasser du bouchon (il s’agit d’un bouchon de
champagne). La secousse manque le déséquilibrer. Il n’a
que le temps de porter ses mains gantées de trous à son
guidon. On le tire, je prends de la vitesse. Au début il a
le cou allongé par-dessus son vélo. Il tente toujours de se
défaire de cette poire d’angoisse, mais sa mâchoire de mulot
n’est pas apte à servir de réceptacle à un objet de cette
fore et de cette dimension. Force lui est de suivre. Il se
résigne, s’organise. Il trouve ça bon, malgré tout, cette
traction providentielle. Il est comme qui dirait dans le
cosmos, Alonzo. La pesanteur c’est plus pour lui, il s’est
affranchi. L’archange Béru l’emmène sur ses ailes dorées
vers le sommet glorieux.
Nous recollons une fois encore au peloton de plus en plus
pointillé. Je klaxonne véhémentement pour obtenir le
passage. La foule acclame le retour en force de Giro.
-Vas-y, Alonzo ! qu’elle lui crie, la foule, ils sont pas
loin !
Alonzo grimpe les pentes jurassiennes à soixante à l’heure.
Au passage, je vois un reporter noter fiévreusement sur son
bloc à débloquer que le « Condor des Pyrénées, dans une
irrésistible envolée d’aigle impérial, se rit des plis
anticlinaux jurassiques ». La phrase reste belle bien qu’il
ait, dans sa hâte, oublié un « r » à irrésistible.
Nous dépassons les demi-porcifs, les porteurs d’eau, les
échangeurs de roue, les coupeurs de train, lesquels
subissent l’épreuve de vérité qu’est la montagne. Et puis
nous retrouvons les champions des courses classiques mal à
l’aise dès que les routes se mettent à basculer. J’avise
Tik Danloeil, André Barricade, Stable-Enski, Rudy Manther,
Van d’Ouest, Krokzy et d’autres encore, le dos arqué, le
regard en visière, la bouche entrouverte.
On se les paie, on les double, on les perd, entraînant dans
notre sillage l’éblouissant, le réputé Alonzo Giro,
incroyable d’aisance, lequel non seulement escalade la
Faucille les mains en haut du guidon, mais presque en
faisant roue libre ! Un exploit ! J’entends, en le
dépassant, un gars de Radio-Brandgbourg dire aux z’auditeurs
que le roi de la montagne est en train de devenir le
Roi-Soleil.
Nous parvenons à la hauteur de Jeannot ! Il est ravi, le
dirlo sportif du Fafatrin. Il exulte. Sur une ardoise il a
écrit « Courzidor à 30 ». Il brandit le panneau sous
les yeux exorbités de Giro qui secoue la tête
désespérément. A l’allure, où on l’entraîne vers la
victoire, il a du mal à conserver son équilibre, le pauvre.
Béru, qui regarde gesticuler Jeannot, s’inquiète.
-
Cet abruti va couper le fil à gigoter commak. Donne un coup
de sauce, Gars.
Docile, votre San-A., mes loutes ! Au service du Preux Béru.
Dévoué corps et biens, corps et âme, l’arme sur le pied de
guerre.
Je frictionne le champignole. L’aiguille marque 80.
Quelques secondes s’écoulent. Je suis les embardées de Giro
dans mon rétroviseur. Il a pris le parti de pédaler à mort
pour garder son équilibre. La foule, médusée, se tait. Un
grand moment de l’histoire du cyclisme s’accomplit.
Nous rattrapons Jacques Anguenille, superbe pourtant dans
son beau maillot vert de l’équipe des Moulins à Légumes
Tournicoton. Et puis c’est le maillot jaune Richard Pini
que nous sautons sans façon. Courzidor est en vue. Il
grimpe d’un bel élan, à coups de guiboles robustes.
Han ! Han ! Han !
Il dodeline à peine le buste. De temps à autre il file un
coup de périscope par-dessus son épaule afin de mesurer son
avance. Nous le passons. Il nous adresse un clin d’œil.
Mais soudain il pâlit mochement en voyant filer un météore à
son côté. Il tente d’accélérer. Il accélère sans doute,
mais que peut-on faire contre un type lancé à quatre-vingts
à l’heure dans une côte ? Il se sent battu, perdu,
mystifié. La Faucille lui coupe les jambes ! Elle le fait
devenir marteau.
Nous voilà presque au sommet du col.
-
On largue les amarres au sommet ? je demande à mon
« patron ».
-
Qu’est-ce que t’en penses ? condescend-il.
-
Ça vaudrait mieux, tracter un zig dans une descente en
lacets, c’est pas prudent.
Tout à coup, Béru pousse un cri. Il vient de morfler un
projectile dans le coin de la bouilloire. Il porte la main
à son oreille qui saigne et se penche sur la banquette de
veau (les sièges sont en cuir).
-
Malédiction ! fait-il comme dans les romans d’Alexandre
Dumas père.
Et il recueille un très étrange objet : le râtelier d’Alonzo
mordant toujours le bouchon. Son ustensile à croquer les
croque-monsieur, trop sollicité par la tension du filin, a
choisi la liberté, au Condor. Le fil de nylon élastique l’a
ramené à nous.
Jolie pêche ! Belle prise ! Trois dents en or pour faire
plus vrai dans ce damier complet ! Mazette, c’est un signe
intérieur de richesse pour l’Espagne ! Maintenant le Condor
vole bas. Il est en pleine dérive. Les cannes coupées,
redevenues de plomb, brusquement. Il a réintégré durement
sa pesanteur originelle, Giro. La reprise est dure avec la
réalité. Elle monte, la réalité ! Elle fait des boucles !
Elle est poussiéreuse ! Le soleil cogne dessus ! Et
là-bas, plus bas, dans un virage, Courzidor, qui a aperçu le
maillot quasi immobile de l’Espanche, trouve un regain
d’énergie.
J’exécute une marche arrière. On ne peut plus remettre ça
avec le fil de nylon, y’a trop de monde. Et puis le
râtelier s’est brisé en mordant le lobe de Béru. On ne peut
qu’exhorter Alonzo. Le doper de paroles !
-
T’es à deux cents mètres du col, Alonzo ! lui crié-je. Du
cran !
Il a un geste évasif. Sa bouche ressemble à un casse-
noisettes. Une mâchoire en bec de marteau, il a pris le col
de la Faucille.
-
Pédale, hé, feignant ! hurle la Béruche. Tu te figures tout
de même pas que tu vas faire le Tour en pullman !
-
J’ai plus mes dents ! fait-il en pleurnichant et en
espagnol.
Bérurier qui a compris ricane :
-
Justement, tu risqueras plus de mordre la poussière !
Il se dresse sur ses pédales, le pauvre Condor, mais sans
avancer. Le Condor est toujours debout lorsque Courzidor
débouche du dernier virage.
-
Fonce ! Fonce ! crie la foule.
-
L’Espagne te regarde ! m’écrié-je.
-
Et si t’as de mauvaises notes, Franco te fera fusiller en
rentrant ! complète le Gros.
Alonzo Giro a-t-il compris ? Toujours est-il qu’il avance.
Un demi-tour de roue ! Un tour complet. On s’égosille !
On le supplie ! Il remet ça…Mais Courzidor arrive
inexorablement.
Béru replonge dans son inépuisable valoche. C’est la corne
d’abondance salvatrice ! Il ouvre une boîte, prend une
pincée de quelque chose et laisse pendre la main hors de la
portière. La foule n’a d’yeux que pour Alonzo qui
mollassonne et pour Courzidor qui fuse. Plus que quinze
mètres entre les deux coureurs ! Plus que dix…Plus que
cinq…
L’Espagnol cherche son énergie dans la poche de son maillot
et ne trouve pas. Courzidor radine. Plus que deux mètres.
Et voilà qu’il crie « Merde » et s’arrête. Il a crevé.
Son directeur sportif Michel-Ange Gémi (célèbre parce qu’il
n’a jamais gagné le Tour de France) se précipite avec une
roue neuve.
Pendant qu’on remet en état la bicyclette de Courzidor, nous
remontons au niveau de l’Espagnol. Il récupère. Y a rien
qui dope mieux un champion que les déboires de ses
concurrents. Et puis la foule énorme rassemblée au sommet
galvanise littéralement en scandant son préblaze. A-lon-zo,
A-lon-zo !
Il retrouve ses forces, le king de la montagne. Il se
déhanche un bon coup.
Courzidor repart et redit « Merde » immédiatement parce
qu’il vient de crever. Un journaliste de La Pédale du
Soir est en train de noter fiévreusement dans son carnet
que « Dieu des sommets excommunie le courageux
champion ». L’image est de toute beauté et fera
sûrement monter le tirage de La Pédale, ce qui n’est
pas négligeable, vu que dans la presse il y en a beaucoup
d’imprimés mais peu des lus.
-
Il a pas de bol, compatis-je.
-
- Par contre, murmure Béru, il a toutes les semences de
tapissier que je viens de larguer sur la route ! Si après
ça Alonzo ne gagne pas l’étape c’est qu’il a du jus d’huître
dans la canalisation !
-
Tu as fait ça ! m’étranglé-je.
-
Et alors ! Tout pour le succès de l’équipe ! […]
San-Antonio
« Vas-y Béru »

bruffaertsjo@skynet.be
|
|