Bivouac au « Moulin
Papillon », un gîte d’étape où je fourbis mon vélo avant
l’ascension des premiers grands cols.
Les trois sœurs m’installent à l’étage dans un petit
dortoir où il n’y a pas une âme qui vive. Souper et
veillée sans histoire. La « Michelin » est dépliée pour
la énième fois et, malgré la distance restreinte de
l’étape, j’écarte la route départementale en corniche au
profit de la nationale qui lui fait face sur le versant
opposé. Droit au but, rien de tel en randonnée.
Mon paquetage rejoint la « bique » avant le chant du
coq. En silence, parce que toute la maisonnée se
prélasse encore dans les bras de Morphée.
Chic ! Les filles ont préparé un copieux déjeuner que
j’engloutis sur le pouce.
Me voilà donc pédalant
allègrement, à la pique du jour, sur une nationale
quasiment déserte qui va à Briançon. Je ne regrette pas
mon choix de route quoique, si j’étais parti un peu plus
tard dans la matinée, ce tronçon de route eût été
probablement un calvaire à cause de la circulation.
Briançon. La ville basse s’éveille. Comme partout
ailleurs en France, on observe un développement accru de
l’agglomération en périphérie des villes. Briançon ne
fait pas exception à la règle. C’est la large vallée de
la Guisane qui éponge en grande partie cette explosion
urbanistique. Je néglige le centre de la ville pour
l’avoir visité déjà sous toutes ses coutures. En effet,
puisque les fortifications de Vauban, notamment sa
porte, m’ont déjà livré tous leurs dessous, ça ne me
sert à rien de lanterner au pied des remparts qui
n’intéressent personne en c’tte heure matinale.
Par contre, la route frontalière vers l’Italie voit son
charroi et l’afflux de touristes s’accroître de minute
en minute. Aussi, dès les premiers lacets du col de
Montgenèvre, suis-je accueilli par les bonnes odeurs
d'oxyde de carbone ! Comme dix ans plus tôt, je me
retrouve coincé entre deux autocars qui crapahutent à
allure poussive ! Mes poumons s’en tapent plein la
caisse ! Ici, pas question de belles lignes droites
comme dans le Lautaret. Au col, la station a pris de
l’extension depuis mon dernier passage. Après quelques
minutes de repos dans une des rares cafétérias ouvertes,
j’ignore la stèle érigée en hommage à Napoléon et je
dévale la montagne aride vers Clavière qui fait office
de poste frontière entre la France et l’Italie. La
localité fleurie dégage de la sympathie, une invitation
à flâner que l’on ne retrouve pas sur les hauteurs.
Un rien plus bas, la petite cité piémontaise de Cesana
Torinese fait le plein auprès du public italien. Elle
grouille de touristes qui arpentent les ruelles
proprettes. Les bacs de géraniums rouges et de pétunias
pourpres alignés sur les appuis de fenêtres rivalisent
d’éclat avec les brassées de pélargoniums d’un rose
tendre qui reposent sur le seuil des demeures. J’ai
l’impression d’assister à une orgie florale.
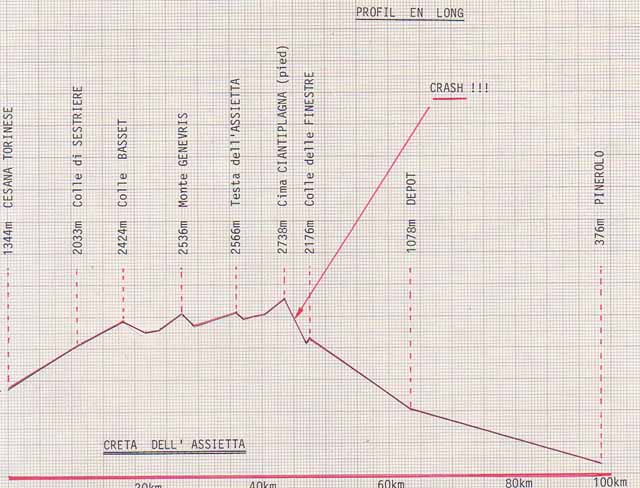
C’est
l’heure du berger. Sans la présence de Vénus. Le temps
est au gris et l’horizon est bouché. La promenade sur la
crête de l’Assietta est donc remise au lendemain.
Néanmoins, craignant la pluie, je me décide à franchir
en vitesse les sept cents mètres de dénivellation qui me
séparent du col de Sestrières (2033m). Ne pas devoir
sécher mes frusques, c’est déjà ça de pris sur
l’adversité. La route, qui développe un pourcentage
constant, est roulante et s’élève dans une montagne
perdue sous la tristesse.
La circulation est quasi nulle sur la voie d’accès qui
mène à la station d’hiver de Sestrières. Pendant que je
m’échine à mouliner, la plupart des touristes sont
occupés à tendre la peau de leur ventre. Je déguste la
tranquillité qu'ils me procurent. Car la largeur de la
route est faite pour absorber un trafic dément tout au
long de l'année.
Tous les sommets qui dominent la station de Sestrières
sont perdus sous un ciel noir prêt à pleurer des larmes
amères. Il fait frisquet. Malgré les rigueurs du climat,
des brocanteurs venus des quatre points cardinaux
exposent des vieilleries, des fonds de grenier et autres
cochonneries. Du bric-à-brac de chineur. Sur ce marché
aux puces improvisé, ma tenue estivale détonne entre les
lainages et les anoraks des badauds.
Zut ! Le refuge est fermé pour travaux de restauration.
Je me mets en quête d’un autre logis. Au bout de la
quatrième tentative, j’échoue dans un hôtel quelconque
qui me propose une chambre quelconque, baignant dans des
relents de tabac quelconque avec vue sur des toits
quelconques. Ce n’est pas le Pérou espéré mais comme le
temps est couvert, il ne me reste rien de mieux à faire
qu'à courir la prétentaine dans cette sinistre station
de ski en attendant le ciel azur du lendemain matin. En
effet, les folders touristiques proposaient, voire
conseillaient vivement de parcourir la route des crêtes
par grand bleu. De bon matin et de préférence après une
nuit humide. Pour échapper aux nuages de poussière
répandus sans vergogne par les véhicules 4x4. La plaie
du randonneur cyclomuletier !
Mon appétit coliteux étant repu par les 1660 mètres de
dénivelée matinale, je troque la « bique » pour des
baskets de vadrouille en attendant des cieux meilleurs.
Mais j’ai l’intuition, que dis-je, j'ai la prémonition
qu’un grain de sable va gripper mon beau timing pourtant
réglé comme du papier à musique. Je le sens mais comme
je ne suis pas une pythonisse ni Madame Soleil, il n’y a
plus qu’à me remettre entre les mains des bons augures.
Repas frugal à la brune, séance d’empaquetage et grand
détour dans les bras de Morphée.
Col et station de Sestrières
Je
me réveille en sursaut. Sous ma fenêtre, une pluie
frénétique martèle la toiture de l’appentis. Ma toquante
indique une heure du matin. La situation n’est pas
encore dramatique. N’empêche que mon moral accuse le
choc. C'est encore trop tôt pour me faire un sang
d'encre et je me rendors. Trois heures plus tard : même
topo. "M…m…m…". Inconsciemment, j’élabore un scénario
pour éponger la cata que m’impose ce temps pourri. Il
fait trop infect pour que le temps se remette au beau
dans les toutes prochaines heures. Il ne me reste plus
qu’à faire mon deuil de la crête de l’Assietta.
Randonner au-delà de 2000 mètres par temps bouché, passe
encore ! Mais sillonner sous des éléments en furie comme
voilà, ça jamais ! Pour une fois, je me résigne à suivre
la voix de la raison. Celle-ci me suggère la
résignation, c’est à dire replonger illico sous la
couette. Je laisse filer la comète au hasard
.
Quelques heures plus tard. Un inquiétant silence me
cueille au saut du lit. Je risque un œil par la fenêtre.
C'est incroyable ce qui m’arrive ! Phébus se lève de
bonne humeur. Bleu, rien que de l’azur sur toute la
ligne. Il ne reste pas la moindre queue de nuage. Une
fois de plus, la haute montagne tient sa promesse, à
savoir qu’elle se lève très souvent sous un ciel
lumineux.
Rien de tel pour donner un coup de fouet ! Aussi ne m’en
faut-il pas plus pour accélérer mon départ ! D’après mes
notes, cette troisième étape doit être le clou du
périple. Va-t-elle répondre à mes espérances ?
Allé-vélo-luia !
Le tout Sestrières se calfeutre encore douillettement
qui dans les bras de Morphée, qui entre les miches de sa
boulangère, qui sur le sein de son Dieu.

L’accès du colle Basset est facile à repérer. La piste
caillouteuse prend son envol devant la « Résidence
Bellavista », un des derniers immeubles en direction de
Pinerolo. Il me revient avoir lu à maintes reprises que
la piste convenait à toute randonneuse équipée de bons
pneus. Je n’irai pas à l’encontre de cet avis mais quoi
qu’il en soit, quel bonheur d’avoir opté pour le tout
terrain ! En effet, d’emblée, la caillasse taillée en
strate annonce la couleur. Les pneus sont éprouvés
jusqu'à la chape. A la hauteur du premier relais du
télésiège, une escouade de jeeps, qui fait
quotidiennement la navette entre Sestrières et le
terminal de la station en altitude, a labouré tous les
virages et a transformé la piste en un infect bourbier.
Ascensionner dans un nuage de poussière par sécheresse
est une épreuve pénible mais la pluie et les sentiers
boueux présentent parfois des obstacles bien plus
épineux. A tout prendre, la sécheresse m’eût été plus
salutaire. Mais ça, je laisse au lecteur de le trancher
après lecture du récit.
Revenons à ce régal visuel
que dévoile la crête de l’Assietta. Le sommet du colle
Basset (2424m) offre de splendides échappées sur le
Chaberton, les neiges éternelles du massif de la Vanoise
et un coup d’œil sur l’à-pic vertigineux qui plonge dans
la vallée d’Oulx. Le col vaut indiscutablement son
pesant de panoramas. Sublime ! Un préalable est
toutefois indispensable : la couverture nuageuse doit
briller par son absence. Un ciel azur est la condition
sine qua non pour le fameux ticket vers le septième
ciel.
La piste en terre battue, malgré les ornières et les
fondrières creusées par les engins motorisés, est un
lieu privilégié pour les cyclotouristes contemplatifs.
Elle se love sur les flancs d’une montagne grillée par
le soleil. Sans effort, on passe de l’adret à l’ubac,
sans s’en rendre compte, si ce n’est que l’on quitte le
soleil pour l’ombre. Les colle Bourget (2299m) et di
Costa Piana (2313m) sont ainsi pratiquement franchis en
roue libre. Le chemin muletier redresse alors sèchement
du col pour donner accès au Monte Genevris (2536m).
Dégringolade au colle Blegier (2381m) et re-grimpette à
la Testa dell’Assietta (stèle) via le colle Lauzon
(2497m) suivi du Colle (2483m). Bref, on roule entre
ciel et terre. Entre le profane et le céleste. Dans
l’antichambre du paradis. Excepté une bergerie isolée
blottie au creux d’une combe et quelques vaches, la
présence humaine, qui n’est pas encore parvenue à
dénaturer cet environnement exceptionnel, est plutôt
rare. C’est donc par une succession de séances de roue
libre et de douces grimpettes qu'est atteint le
carrefour du colle dell’Assietta (2472m), position
stratégique où je décide de faire le point.
J’en profite pour me
soulager quand tout à coup, un motard transalpin choisit
ce moment précis pour surgir derrière moi. Il n’en faut
pas plus pour qu’un randonneur solitaire se mette à
tailler une bavette. N’exagérons rien ! Comme le compère
ne cause que sa langue maternelle, je m’escrime en petit
nègre « espérant tôt » lui soutirer un renseignement au
sujet du sentier qui s’échappe vers les fortins del Gran
Serin. Il se creuse un moment les méninges et me conte
brièvement que, lors d’une escapade pédestre antérieure,
il se souvient que le chemin ne se prête absolument pas
à la pratique de la moto. Cette information ne me
rassure pas des masses mais, c’est sans compter sur
l’appétit inassouvi du chasseur de cols. La spontanéité
de cet élan se justifie dès que le lecteur a saisi
l’importance de la force d’attraction exercée par un col
sur un chasseur de cols. Il a le même effet que l’aimant
sur la limaille de fer. Soit, irrésistible.
Me voilà donc embarqué sur ce sentier à peine tracé. La
matinée avance. Les nuages font leur apparition. Pas
n’importe lesquels ! Des nuages gris, opaques et lourds
qui sont décidés à me faire endosser leur humeur
chagrine. Les pisse-vinaigre s’accrochent au flanc de la
montagne comme des teignes. Néanmoins, ces trublions ne
m’intimident pas trop et je me lance à l’assaut du colle
Gran Serin (2540m). Non ! Sans blague ! Un peu de
sérieux ! Je ne vais tout de même pas me débiner pour si
peu, alors que quatre cols de plus de 2000 mètres en
quelque dix bornes ne demandent qu’à se faire accrocher
à mon tableau de chasse. C'est un renoncement qui serait
indigne de la part d’un « cent cols ».
Trois jeeps s’en viennent à ma rencontre. C’est bon
signe ! Le motard aura eu probablement un trou de
mémoire. Autour de moi, la caillasse tient le haut du
cloaque. Aride. Un monde minéral froid où la piste
continue à se dégrader. Toutefois, toujours abordable
pour un VTT. Chemin faisant, je débouche sur un replat
qui, autrefois, a été le siège de casemates au vu des
ruines qui encombrent le passage. En effet, je me situe
tout bonnement sur la piste militaire DA SP 172 qui
traverse le « Parco Orsiera Rocciavre ». Vestige
stratégique qui appartient désormais à l’Histoire.

Piste militaire
Au-delà
du colle Gran Serin, la voie se rétrécit et quelques
passages scabreux me donnent à réfléchir. Des avalanches
de pierre ont emporté la piste sur deux ou trois
longueurs. En fait de chemin, il ne subsiste plus qu’un
filet de terre carrossable large comme un pneu de moto.
Tout le reste n’est qu’un éboulis. La désolation ! Une
passeport pour l'éternité !

Qu’est-ce que j’ai fait au bon Dieu pour venir traîner
ma misère dans ce coin perdu ? En vitesse, je revisite
mes classiques. Petite digression : les classiques sont
une matière première indispensable pour entretenir et
meubler les araignées que je chéris dans un coin de mon
plafond. Il me souvient d’avoir lu quelque part que « la
chaussée reste rocailleuse jusqu’au colle Gran Serin
pour aboutir ensuite aux remarquables forts du Gran
Serin. Au-delà, la montagne prend progressivement le
dessus de la piste. Une extrême prudence est de rigueur
sur cette sente étroite et périlleuse. Ce n’est pourtant
pas l’enfer comme on pourrait le croire, mais bien le
paradis… ». Pour ce qui est de l’aspect remarquable du
fortin, je crains que l’auteur de ces lignes ait forcé
un peu trop sur le gros rouge lors de son passage entre
les ruines de l’ancienne place inexpugnable. Quant à la
piste, ça colle à la réalité d’autant plus que des
traces fraîches de pneus de moto attestent que le chemin
est encore fréquenté. Ces petits riens me rassurent et
me confortent dans ma décision de poursuivre ma quête
sur cette sente. Mes idées ne font qu’un tour dans ma
tête. En effet ! Sachant que si une moto force un
passage, il est logique qu'un vélo bien plus léger
puisse se promener là où le gros cube s'est faufilé.
Fort de ce raisonnement, j’étais persuadé que mon étoile
était inaltérable. En outre, ce sentier ne pouvait
aboutir que sous le colle delle Finestre (2176m).
C’en est fini du paysage. La purée de pois qui
m’enveloppe, m’oblige à concentrer toute mon attention
sur le sol où je mets les pneus. Le sentier reprend de
l’altitude et, entre deux trouble-fête chagrins,
j’aperçois à la dérobée des paysages vertigineux. Une
montagne escarpée, nue, sèche, avec des précipices
impressionnants. Le brouillard est épais au point qu’il
m’impose une marche à tâtons. C’est plus du vélo, c’est
de la démence ! Le moral tient le coup. Surtout que j’ai
le pressentiment d’être tout près du sommet de la «
Punta de Mezzodi », le point culminant du massif.
Bingo ! Voilà que j’entends des bruits étouffés d’enduro
qui viennent à ma rencontre. Chic ! Je ne suis pas le
seul dans cette galère !
Un premier motard apparaît comme un fantôme sortant
d’une nébuleuse. Cinq complices suivent roue dans roue.
J’interpelle le chef de file qui me confirme que je fais
bonne route.
« Le colle delle Finestre est encore à plus de vingt
minutes » s’empresse-t-il d’ajouter.
Ces derniers mots me font l’effet d’une douche
écossaise. Il est trop tard pour faire demi-tour, je
suis trop engagé à c’tte heure. Que voulez-vous faire
contre mauvaise fortune, sinon pédaler et encore
pédaler. Je maintiens le cap.

Sont
ensuite franchis comme sur des roulettes, le colle di
Vallon Creux (2552m) et le colle del Vallette (2551m).
Ah ! Si ces fichus nuages avaient voulu déménager un
instant de secteur ! Chimère que tout ça ! Au contraire,
les vaches s’accrochent avec âpreté aux rochers,
m’empestent l’existence et bouchent mon horizon. Après
de petits travaux cyclo-herculéens, je me retrouve sur
l’adret de l’univers rocailleux. Le paysage que
j’entrevois, l’espace d’un éclair, me donne la chair de
poule. L’abîme est omniprésent. Epoustouflant !
Etourdissant ! Dingue !
Brrr ! L’Assietta me propose-t-elle une descente aux
enfers ?
Doucement ! Très prudemment, j’aborde la descente avec
un maximum de concentration. Pour rendre le passage
accessible, les ingénieurs ont eu recours à de
nombreuses constructions en corniche. Altitude
approximative : 2500 mètres. Pas une âme, pas une
bestiole à l’horizon. Une inscription « In Memoriam »
retient mon attention. Un petit gars qui apparemment n’a
pas eu de bol. En face de la plaque commémorative, c’est
le fatal plongeon dans les profondeurs incommensurables.
Aïe ! Aïe ! Le ruissellement des eaux a raviné le chemin
quelques virages en contrebas du Colle della Vecchia.

Colle della
Vecchia
Soudain, la roue avant de la « bique » bute contre la
paroi de la fondrière. Le vélo s’immobilise et verse
légèrement sur son flanc droit. Du côté du précipice. Je
mets un pied à terre, bascule en douceur la main droite
en extension pour éviter la chute. Au contact de ma
dextre, le bord de la piste, rendu meuble par les pluies
de la veille, s’écroule comme un château de cartes et me
fait piquer directo la tête la première dans l’abîme. Le
prix du défi. Je chute trois mètres en contrebas sur une
pente herbacée à 45 degrés parsemée d’écueils
rocailleux. Roulant boulant, mon corps, désarticulé
comme un pantin, prend immédiatement une vitesse
vertigineuse. Inénarrable !
Incontrôlable ! L’herbe mouillée accentue l’effet de
glisse. De cabriole en culbute, je n’ai pas le temps de
m’apprêter à comparaître devant l’Eternel ! Qu’est-ce
qui m’attend au fond du ravin ?
L’écrasement contre un roc ? De la charpie pour choucas
? Chaque rebond me vaut une volée de coups. A tout prix,
il me faut mettre fin à cette dégringolade sinon j'ai
mon blanc seing pour le broyeur de tête pressée qui
trône sur l'étal du boucher de Fenestrelle .
Je refuse de rendre les armes. Une première tentative
d’accrocher un gros caillou échoue d’un rien. La valse
en arrière repart de plus belle. Une dizaine de mètres
plus bas, grâce à l' instinct de survie poussé à son
paroxysme, je glisse une fraction de seconde sur le dos,
mon talon gauche bloque net la chute.
Eberlué, contusionné, abasourdi, je me ramasse tout à
trac. Le tocsin sonne le glas dans ma tête. Un silence
mortel règne dans ce trou. Vivant, je suis vivant !
Est-ce bien vrai ? J’ai du mal à le croire car je me
suis vu rayer du monde des vivants. Cette gamelle relève
du miracle ! Soit ! Mais passer l'arme à gauche sans
aller à confesse, ça n'est pas très catholique ! Le bon
Dieu m'accorde donc encore une chance de faire amende
honorable !
Un balluchon passe près de moi, rebondissant en
souplesse d’une pierre à l’autre et s’en va se coincer
contre un amas d’éboulis. C’est mon « Gore Tex » qui
descend en dilettante. Mon thorax et mes bras me font
souffrir le martyre. En revanche, peu d’écorchures et de
blessures ouvertes. Grâce probablement aux multiples
pelures de vêtements que j’avais enfilées avant
d’entamer la descente. Sans le réflexe de la dernière
chance, il y a gros à parier que mon sort eût été fixé
pour l’éternité. Quelques mètres de plus et un ramassis
d’éboulis se chargeait de me réduire en une bouillie
sanguinolente. De la hure à la sauce « fenestrelle » !
Je fais un demi-tour sur moi-même. C’est absolument
ahurissant ce que je vois. Je n’en crois pas mes yeux.
Trente mètres au bas mot me séparent du muret qui
soutient la piste ! L’horreur ! Que faire ? Mais…le
moral à zéro est un luxe qui m’est présentement
interdit. Il me faut absolument m’extraire de ce piège à
rats. Premier souci : récupérer le « Gore Tex ».
Deux choses me chagrinent ! Primo, je ne parviens pas à
localiser l’endroit exact de la chute. Secundo, où est
passé la « bique » ? Qu’est-elle devenue ? L’idée de
fixer les lieux pour la postérité me passe par la tête.
Las, je n’en ai pas le cœur et puis ça me fait
horriblement mal d’aller farfouiller dans la poche
dorsale du maillot. Il y a plus urgent à c’tte heure !

Crapahuter, c’est ce qui me reste de mieux à faire. Et
vite ! Car le risque d’immobilisation en cas de
refroidissement est imminent. A quatre pattes, je
remonte maladroitement la rampe jusqu’au pied du muret.
Ensuite, il me faut franchir ce redoutable obstacle haut
de cinq mètres. Dur…dur de garder la tête froide quand
on vient de se ramasser une pelle mémorable ?
Faisant abstraction des meurtrissures, je m’applique à
mettre en pratique, un tant soit peu, les principes
élémentaires de la varappe qu’un bon copain de la belle
époque s’était évertué à ancrer dans ma caboche. Bien
choisir les prises et bien décoller le corps de la
paroi. Facile à dire ! Une hantise me colle à la peau.
Si je dévisse, ça sera irrémédiablement la fin des
haricots.
Horriblement difficile ! L’exercice que je m’impose est
inhumain. C’est celui de la dernière chance. Donc, je
risque le tout pour le tout.
Grâce probablement à mes bons états de service, le bon
Dieu des cyclos ne m’a pas lâché !
Allé-vélo-luia !
Une fois parvenu sur le muletier, jetant un œil dans le
vide, je vois la « bique » qui gît complètement
désarticulée une dizaine de mètres en contrebas.
Beaucoup plus vers la droite. Ma chute a été de traviole
ce qui explique mon état déboussolé d’un instant plus
tôt. Le VTT affiche un piteux état mais, contre toute
attente, les sacoches sont encore arrimées au
porte-bagages. Il n’en faut pas plus pour que j’aille y
voir de plus près malgré la réticence de mes os brisés.
De grâce, pitié ! "Epargne-nous tes frasques kamikazes !
" me crient-ils de concert.
La « bique » paraît moins abîmée qu’au premier coup
d’œil. Le guidon a pivoté d’un demi-tour à droite. Le
cadre, que j’ai cru brisé, est intact. Quoique ! Quoique
le hauban inférieur droit me donne l’impression d’être
plié. De toute façon, ce qui est une certitude, c’est
qu’il n’est pas du tout symétrique à l’autre côté.
Encore que ! En un mot comme en cent, je ne suis plus
sûr de rien. Je suis paumé. Mon premier soin est de
détacher les sacs du vélo. Ensuite, séance laborieuse de
ramping ! Voilà un sport à recommander à ceux qui ont un
problème de cage thoracique ! Quelques mouvements de
reptation et la vie s’éclate dans la caisse !
Chassant vaille que vaille les sacoches devant moi, je
m’échine ainsi jusqu’au pied du mur effondré. Une fois
les bagages sur le chemin, je redescends en enfer
chercher la bécane. Le tocsin bat la chamade dans ma
poitrine. Comment vais-je m’y prendre pour remonter la
bique » ? C'est pas le moment de faire des phrases de
coiffeur. Pour la première fois de ma vie, il me faut
réinventer l'eau tiède.
Dans un premier temps,
cette entreprise me paraît irréalisable. La tirer à bout
de bras relève de l’impossible. Mais comme un Ménapien
est aussi un peu Français sur les bords ( le Français
n’est-il pas le seul à avoir des idées !), je commence
par redresser le guidon et puis, entourant ce dernier
d’un élastique extenseur, je la traîne jusqu’au pied du
muret effondré.
Problème ? Comment faire maintenant pour la remonter sur
la piste ?
Puisant au plus profond de mon être mes ultimes forces,
je prends la roue avant à pleines mains. Ensuite, je
bascule la « bique », lui faisant prendre une position
non conventionnelle. La roue avant perpendiculaire à
celle de l’arrière ! Position verticale et, sautillant
d’éboulis en éboulis sur sa roue arrière, la « bique »
retrouve enfin son domaine de prédilection qui est le
chemin. Combien de temps s’est-il écoulé depuis la chute
? L’archange « Végalo » me le dira le jour si je vais au
paradis !
Par contre, cette opération de récupération pompe le
reliquat de mon énergie. Ajustage rapide du guidon, de
la chaîne et du patin de frein arrière. Arrimage des
bagages. Une furieuse envie me tenaille soudainement le
ventre : « Décamper sur-le-champ de ce trou à rats ».
Il me semble que le guidon s’est rapetissé. Gênant ! Une
douleur lancinante me martèle le bas du dos à la moindre
irrégularité de la piste. Atroce ! Ce n’est qu’au bout
d’un certain laps de temps que je remarque que le « Gore
Tex » manque à l’appel. Que le diable l’emporte ! Avec
ma bénédiction ! Je n’ai pas le courage de faire
demi-tour. Le bilan exact des dégâts matériels, c’est
pour plus tard. Comme que je me situe à plus de 50
kilomètres de Pinerolo, mes préoccupations sont d’un
tout autre ordre.
Parvenu sur la route de Susa-Fenestrelle, située à 300
mètres sous le Colle delle Finestre, je brûle ma
dernière cartouche pour un ultime baroud d’honneur : «
Epingler le col à mon tableau de chasse ». Je refuse de
me plier à la voix de la raison si près du but. Quoi
qu’il advienne !
Extrêmement dur ! Aux limites du supportable.
Complètement malade le mec, me direz-vous ! Sans nul
doute. Mais quand on est fêlé, un peu plus ou un peu
moins, ça ne risque pas de changer le cours de
l’histoire.

En
vérité, le cœur n’y est plus. La route en terre battue
zébrée de rigoles m’en fait voir de toutes les couleurs.
Du jaune pâle, mon rictus vire au citron avec un zeste
de vert si trouille. Les idées noires ne me lâchent plus
les baskets. Le paysage diapré ne m’intéresse plus.
Pourtant le passage sur les hauteurs de Dépôt est un
véritable régal visuel.
Une idée fixe me trotte dans la caboche : rallier au
plus vite l’hôpital civil de Pinerolo, une petite ville
piémontaise blottie dans la vallée de Chisone.
Quinze heures. Mon épigastre hurle de faim. Normal !
Voilà deux jours que je n’ai plus ingurgité quelque
chose de chaud. Je m’arrête à Roure en quête d’une
pizzeria. Broquette ! La cuisine est fermée. Quant au
bistrot du village, il n’a rien de mieux à m'offrir
qu’un coup de rouge. Mon coupe-vent en charpie, mes
ecchymoses et mon désarroi laissent le patron et les
joueurs de cartes tout à fait indifférents. Ils ne
daignent même pas lever la tête. Cette sécheresse de
cœur, cette impassibilité, voire ce dédain constituent
la cerise sur le gâteau de ma déconfiture.
Une heure plus tard, je me présente, le ventre creux et
la mine défaite pour un contrôle médical aux urgences de
« l’Ospedale ». Simplement pour un examen sommaire car
je me méfie du contrecoup qui pourrait me clouer au lit
le lendemain matin. On dirait que ma bécane connaît le
chemin par cœur puisqu’elle rentre dans l’établissement
comme un pigeon dans son pigeonnier.
A quoi ressemble l’hosto ? J’en sais trop rien. Par
contre, une bouffée d'acide phénique me saoule dans le
sas d'arrivée des urgences. « Avanti », le cirque peut
commencer !
Automne
1995
(Suite du récit dans
"Vol au-dessus d'un nid de marmottes" disponible chez
l'auteur)